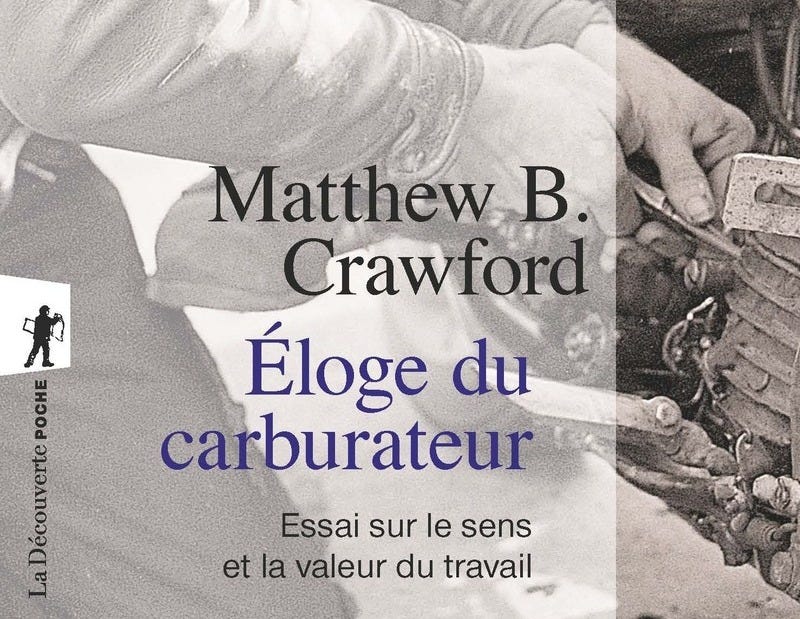L’Alpe comme culture commune (2). Faire par soi-même
Quand on fait des choses, il se passe forcément quelque chose. Quand on ne sait pas par où commencer, commençons par avancer le pied droit puis le pied gauche. C'est bon, on est en marche :-)
Auteur de Les Alpes du Futur (Editions inverse, 2024), je suis fermement convaincu que l'expérience historique est un formidable outil au service des territoires alpins. Mon CV est ici et mes offres de conférence et de conseil sont de ce côté-là :-) Pour en discuter, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse suivante : severin.duc@backfuture.frEntamée en début de mois, ma dernière série de l’année s’intitule « L’Alpe comme culture commune ». Décomposée en trois articles complémentaires, elle a pour but de définir (de manière personnelle) ce qui fait qu’en montagne « ce n’est pas tout à fait comme ailleurs ». Sans prétendre à dire que c’est mieux en-haut, l’idée est de réfléchir aux traits distinctifs de la vie en montagne, à ce qui nimbe et habite notre présence somme toute modeste dans les hautes-terres.
Pour ce faire, je vous propose trois pistes :
le rapport au silence et à la solitude (le lien est ici).
la prise d’initiative (faire par soi-même, c’est le thème d’aujourd’hui).
la force du collectif (faire œuvre commune).
À ce titre, le Festival d’Autrans est un bel exemple de ce que peuvent faire les lieux alpins, et de voir ce qui se passe quand des montagnards prennent des initiatives et travaillent ensemble. À ce titre, j’ai été heureux de pouvoir débattre avec Guillaume Desmurs et Fiona Mille de l’avenir de nos montagnes.

1/13. Dans les Alpes, nous avons toujours pris appui sur les contraintes du milieu pour produire quelque chose de “vivable”. Longtemps, la prise d’appui a porté des fruits modestes mais honorables. Nos “paysages naturels” sont les grands héritiers d’une civilisation alpine de la patience, ainsi les prés et champs autour des villages, les forêts, les ponts, les alpages et les chemins de montagne.
Depuis un siècle et demi, les moteurs ont tout accéléré. Nous sommes désormais largement en capacité de nous affranchir des contraintes du milieu alpin. Or, cette liberté nouvellement acquise risque parfois de se transformer en licence : parce que je suis en capacité de faire, je ferai tout.
Les droits individuels sans devoir collectif sont le faux-nez de la tyrannie.
2/13. Aujourd’hui, le monde se rappelle à nous. Les cadres de référence deviennent caduques, les saisons débordent ou se rétrécissent, les cieux deviennent illisibles. Après la tentation de la (toute)puissance, on redécouvre la peur. On se replie, on se prend le bec.
Cette attitude n’est pas durable : strictement défensive, elle tétanise. En toute fin, elle devient improductive. Replié dans sa sphère domestique, on perçoit le monde à travers les écrans et on “commente sur les réseaux sociaux”. Pas très honorable, ce n’est pas non plus très viable.
Or, tracer sa voie quand la montagne devient illisible, c’est non seulement possible, mais c’est aussi indispensable, pour ne pas dire vital et salvateur. Comme il y 100, 200 ou 300 ans en arrière, il va falloir reprendre appui sur les contraintes existantes (aujourd’hui, le dérèglement climatique) pour redessiner nos modestes réponses aux défis du monde.
3/13. Cette série et cet article se donnent donc pour objectif de soutenir celles et ceux qui font déjà ou qui désirent “faire”. Cela peut paraître une évidence mais l’écriture doit servir à “dire les choses” et non “assombrir la vue”. On doit être honnête, clair : on doit ouvrir des portes ou, plus modestement, dire que nombreuses sont déjà ouvertes. Celui qui écrit doit maintenir la porte ouverte.
Voilà, écrire, ça doit aider les autres à franchir le pas.
4/13. Puis, il faut aussi aider à tenir la distance. L’incantation au changement, le “call to action” ne suffisent pas. On se mouillera les pieds dans la combe, on se cassera le nez sur la crête, mais en toute fin, on avancera.
Car, la longue aventure du XXIe siècle ne fait que commencer. Nous ne sommes pas des héros : n’est pas skieur de pente raide qui veut. À l’héroïsme technique (la frontale qu’on voit là-haut dans la nuit), on doit adjoindre l’union des forces en prenant appui sur les contraintes. On ne les niera pas mais on ne les rendra pas plus grandes qu’elles ne le sont.
En bref, on fera.
5/13. Le XXIe siècle alpin sera la rencontre des lignes de désir de celles et ceux qui voudront tracer des voies inattendues. On doit bien cela aux petits et aux petites des Alpes : toutes et tous nous regardent, et doivent apprendre de nous, de notre éthique de la responsabilité et du travail bien fait.
Sans restriction, il faut prendre le manche en main, et montrer l’exemple.
Car ce sont les petits et les petites d’aujourd’hui qui affronteront le monde d’après-demain. Toutes et tous devront prendront appui sur leurs vieux souvenirs de leurs aînés qui, en 2024 et après, se sont relevés les manches. De même que nous sommes toujours un peu ébaubis face à la civilisation pluri-millénaire des Alpes, eh bien, on doit devenir des figures exemplaires.
6/13. Il existe mille façons de passer à l’action. Aujourd’hui et demain, pour moi, c’est écrire, écouter, prendre la parole et conseiller. N’est pas charpentier qui veut. Dans un monde alpin du faire, on doit aussi prendre soin des idées, des peurs et des espoirs.
Il faut dire les choses (mais sans s’écouter parler).
Pour d’autres, ce peut être un projet de restauration d’un chemin délaissé, une façon d’enseigner hors-les-murs, une idée de gravir cette paroi autrement, un projet d’entreprise à mener à son terme, une constitution d’une liste citoyenne, un militantisme en faveur d’une zone à protéger, une façon de mieux rémunérer les agriculteurs, un nouveau média alpin et… pourquoi pas restaurer une vieille chapelle ?
7/13. Au début, il y a une volonté de résoudre un problème, donc de trouver une solution. On se dit que “ça ne va pas”. Puis, on se met en route. En chemin, on ignore le regard d’autrui, on trébuche, on rencontre, on bifurque, on apprend. On fait “l’expérience de se tromper”, pour reprendre les mots de Matthew Crawford. C’est là une vertu car “l’échec vous oblige souvent à solliciter l’aide de vos semblables”1.
En un mot, faire par soi-même, c’est multiplier les gratifications internes en tissant les liens les robustes avec le monde qui nous entoure. Plutôt que de chercher du sens dans ce monde (absurde), on trouvera un chemin plus gratifiant en traçant… soi-même sa voie.
Au “pourquoi tout cela” qui nous laisse toujours un peu les bras ballants, osons un “comment faire cela” ? Les réponses viendront en faisant…
8/13. Dans son Éloge du carburateur, un ouvrage de philosophie très concrète, Matthew B. Crawford a magnifiquement réfléchi à ce type d’activité au sein duquel “l’individu y est responsable de son propre travail, et la solidarité du collectif repose sur des critères sans ambiguïté, au contraire des rapports sociaux de manipulation qui prévalent dans le “travail en équipe” des cols blancs”2.
Postulant que “la véritable connaissance naît d’une confrontation avec le réel”, Crawford estime que le travail bien fait peut produire, comme la philosophie, “une communauté de ceux qui désirent savoir”3.
9/13. Citant les travaux de Brewer, Crawford évoque combien notre moteur créatif finit par être brimé s’il recherche les récompenses extérieures4. Est-ce à dire qu’un hobby ne devrait pas devenir une profession rémunérée ? Selon Crawford, “pour être capable de soutenir notre intérêt, un travail doit offrir une possibilité de progresser dans l’excellence”5.
Quand elle n’est pas une incantation vaine à l’individualisme, l’excellence (comme travail constant, durable vers un objectif ambitieux) permet de fixer soi-même ses critères de satisfaction.
10/13. En cultivant le travail très bien fait par soi-même, l’être humain “veut être perçu comme un individu et souhaite que sa valeur soit reconnue en fonction des critères qu’il s’est lui-même efforcé de respecter, voire de dépasser, en cultivant telle ou telle forme spécifique d’excellence ou de compétence”6.
Parce que le monde chaotique et la puissance publique n’ont pas désarmé notre capacité d’initiative, nos Alpes sont encore des territoires du “fait par soi-même”. De proche en proche, par imitation et inspiration réciproques, quand tout le monde prend sa part, se remonte les manches, eh bien un collectif émerge, et celui-là va loin.
Cependant, à un moment donné, il faut bien que quelqu’un mette le baudrier en premier.
11/13. Bien-sûr quand on parle d’initiative individuelle, on se gardera de prôner le privé contre le public. Là comme ici, il y a des gens sincères qui prennent des initiatives décisives et qui, par la suite, entraînent des mouvements collectifs. La simple différence est qu’un fonctionnaire le dira moins souvent sur Instagram que le service comm’ d’une entreprise.
En revanche, si on devait désigner un problème : ce sont les grandes unités, qu’elles soient publiques ou privées, lesquelles, par leur taille, captent, pompent et essorent les énergies individuelles. Dans les “grands machins”, les individus perdent l’autonomie pour imaginer, faire et… former une masse critique.
12/13. Que signifie alors “faire par soi-même” en montagne ?
Selon moi, c’est l’idée que, si on désire voir se réaliser quelque chose dans les Alpes, on cherche à voir ce qu’on peut faire soi-même plutôt que de chercher des responsables au fait que “les choses ne changent pas”.
Ici j’aime bien le sens premier d’autonomie (du grec “avoir sa propre règle”) et non le sens libéral (“démerde-toi”). On sent qu’on a en soi une force de réalisation, une énergie dormante, compactée, désireuse de se transformer en mouvement créateur. L’autonomie consiste à déplier ses forces pour transformer son réel.
13/13. Dans cet espace d’autonomie créatrice, on a envie de dire et d’offrir quelque chose au monde. Le “faire par soi-même” oblige à être concret, à imprimer une marque sur le monde. Le domaine des idées se confronte à la réalité. On les éprouve pour comprendre de quel bois elles sont faites.
Le “travail bien fait” est une somme de compétences orientées vers la réalisation rigoureuse de quelque chose d’utile à soi et à la collectivité. Le “faire par soi-même” est enfin un acte de patience. Il vise la longue durée. Contrairement au court terme qui angoisse, le long terme aura ici la vertu de mettre les choses en perspective.
Au départ, toutefois, quelqu’un doit bien mettre en route les machines :-)
Comment résumer tout cela ?
Je dirais que “faire par soi-même”, c’est montrer l’exemple en commençant quelque chose puis en tenant la distance. L’histoire de la montagne est un enchaînement de gens qui ont pris l’initiative de faire des choses.
On apprend par mimétisme : plus on verra des gens faire des choses, plus on s’autorisera à en faire. En faisant par soi-même, on entre en écho avec d’autres volontés créatrices. En somme, prendre une initiative, c’est partir à la recherche de “ressources dormantes” en soi et au-dehors.
En montagne comme ailleurs, réveiller quelque chose est le meilleur moyen de nouer des alliances et de produire cette chose ensemble. Faire œuvre commune sera justement l’objet du dernier article de la série “L’Alpe comme culture commune”.
En attendant, portez-vous bien.
Séverin Duc.
Auteur de Les Alpes du Futur (Editions inverse, 2024), je suis fermement convaincu que l'expérience historique est un formidable outil au service des territoires alpins. Mon CV est ici et mes offres de conférence et de conseil sont de ce côté-là :-) Pour en discuter, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse suivante : severin.duc@backfuture.frMatthew B. Crawford, Éloge du carburateur. Essai sur le sens et la valeur du travail, Paris, La Découverte, 2016, p. 235-236.
Ibid., p. 230.
Ibid., p. 230.
Ibid., p. 224-225.
Ibid., p. 226.
Ibid., p. 234.