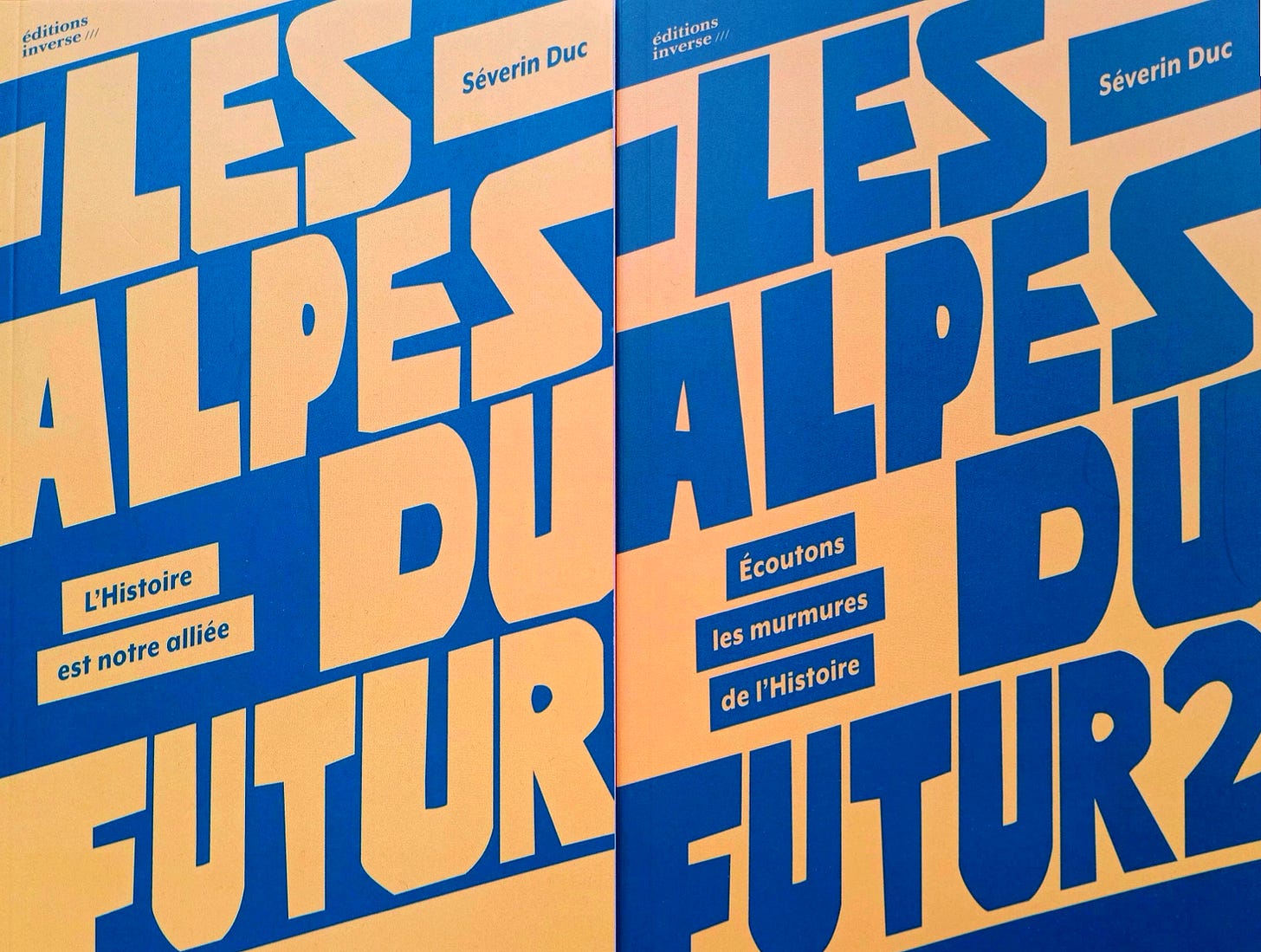Coordonnées diagonales. Nos vies en montagne
Après avoir publié un livre, comment reprendre le fil de l’écriture ? Le plus simple, quand on écrit sur les Alpes, c'est de réfléchir à nos vies en montagne, des vies que j'appellerai "diagonales".
⟶ Docteur en histoire, je suis l'auteur de plusieurs livres dont la trilogie en cours Les Alpes du Futur (disponibles aux Éditions Inverse).
⟶ Ma conviction forte de conférencier et de conseiller est que l'expérience historique est un formidable outil au service du futur des territoires alpins.
⟶ Mes offres sont sur mon site, et mon CV sur Linkedin.
⟶ Pour en discuter, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse suivante : severin.duc@backfuture.frToute œuvre, physique comme intellectuelle, prend de la place dans l’espace et dans l’esprit. Puis, un beau jour, elle se transforme et se matérialise.
Porter un livre à publication laisse immanquablement un vide. Ce fut le cas avec la publication du deuxième volume de ma série Les Alpes du futur.
Mais alors, comment reprendre le fil de l’écriture ? Tout d’abord, il faut se reposer, profiter, à loisir, du travail bien fait et… attendre. Mais attendre quoi ? Je dirais le désir de ressortir le métier à tisser des textes.
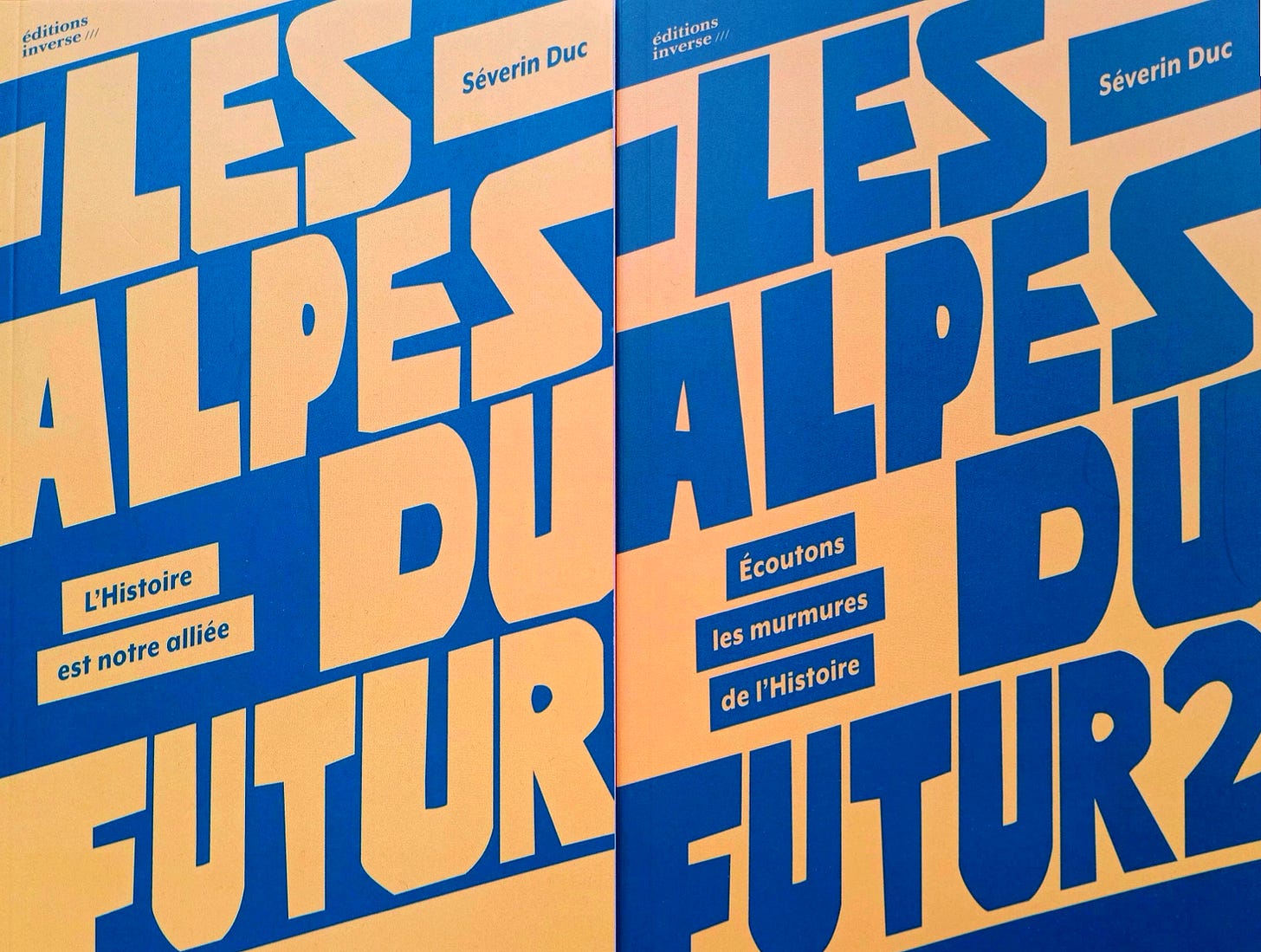
1/15. Pour enclencher un nouveau cycle, on doit repartir de ce qui fait battre son cœur. Dans mon cas, vous l’aurez sans doute compris, c’est l’amour de la montagne. Toutefois, cet absolu risque d’être contemplatif si on ne le couple pas à la puissance énergétique de la montagne : ses pentes, ses ruptures, ses replats, ses hommes et ses femmes qui la sillonnent de long en large et de bas en haut.
Mon nouveau cycle d’écriture a trouvé à Salzbourg sa première inspiration. J’ai eu le plaisir de parler des femmes dans les Alpes à l’occasion du 25ᵉ anniversaire du programme européen Alpine Space. De longue date, je voulais en parler, et j’en reparlerai longuement dans une série consacrée à cette question hautement alpine.
2/15. Au bord de la Salzach, j’ai défendu l’idée que les inégalités hommes-femmes faisaient plafonner la capacité de transformation des Alpes, qu’il s’agisse de l’anticipation, de l’adaptation ou de l’innovation face au changement climatique.
Ma conviction est qu’une société conservatrice et inégalitaire produit une économie du gain marginal et, en toute fin, un système inefficace et coûteux. Or, nos montagnes risquent l’enkystement dans une politique de rustine économique face aux challenges sociaux et politiques de la crise climatique.
3/15. J'ai argumenté que, sans la garantie d’un accès égal à des opportunités enrichissantes et des postes clés, les montagnes risquent de perdre leurs talents féminins épuisées de lutter contre le “plafond de glace” (pour reprendre une expression de Marion Poitevin).
Devant une assemblée de porteurs et de porteuses de projets, j’ai posé la question suivante :
Un projet qui se dit innovant mais qui, dans le même temps, renforce les hiérarchies peut-il vraiment se dire innovant ?
4/15. Aujourd’hui, je vous propose une réflexion qui s’est stratifiée au cours des dernières semaines. Je me suis demandé comment définir nos différentes façons de vivre en montagne et d’essayer de le faire à partir de nos lieux de prédilection et de nos mobilités.
Bien souvent, on considère la montagne comme un bloc alors que notre vie d’en-haut, jour après jour, compose un tableau impressionniste. Les lieux et les actions qu’on y mène sont autant de touches de couleurs différentes.
Saison après saison, année après année, nos vies en montagne forment un tableau mouvant et chatoyant… un peu à la manière d’un Reinhold Messner qui compare ses trajectoires d’ascensions à des tracés d’œuvres d’art.
5/15. Chacune de nos touches de couleur relève de coordonnées particulières, entre deux axes, l’un horizontal (la largeur du tableau) et l’autre vertical (sa hauteur).
Dit autrement, notre vie en montagne, c’est un jeu permanent entre les repos de l’axe horizontal (évoluer sur une courbe de niveau) et les contraintes de l’axe vertical (affronter la pente).
Pour relier les points de nos vies, nous allons de replat en replat, en passant par la pente raide ou en utilisant la courbe. En montagne, d’un point à un autre, nous traçons les coordonnées diagonales de nos vies, lesquelles produisent un univers chromatique d’une rare beauté.
6/15. La montagne est plus qu’une surface à parcourir. Elle est une trame complexe, pliée et crevassée, relevée et abaissée par la tectonique des plaques et l’érosion.
Par les mots, nous devons restituer à l’étoffe montagnarde ses épaisseurs, ses largeurs, ses longueurs et ses surfaces. Cela fait, nous pouvons parler de nos lieux, de nos chemins et de nos vies.
7/15. Les récents événements qui touchent le village de Blatten dans le Lötschental nous rappellent combien nos vies en montagne sont des fleurs prospérant sur un monde minéral sans autre logique que la physique de son effondrement.
Kanton Wallis ruft für Blatten besondere Lage, Tagesschau, SRF, 28.05.2025.
Le village de Blatten en grande partie détruit par l'effondrement du glacier de Birch, RTS, 28.05.2025.
8/15. Comment mettre en concordance l’écrasant poids du monde minéral et la vie des humbles humains à ses pieds ? Doit-on en conclure que nos vies en surface, parce que relativement insignifiantes au regard de l’histoire profonde des Alpes, ne méritent pas qu’on y prête attention ? Doit-on simplement s’intéresser aux grandes unités et aux phénomènes de force ?
L’être humain n’est que ce qu’il est, mais cela vaut le coup, quand même, de réfléchir à sa présence dans les Alpes… qu’elle soit verticale, horizontale ou diagonale.
9/15. Définissons donc ses coordonnées verticales : elles représentent la suite de lieux qu’on traverse en même temps qu’on change d’altitude. Ce sont les fameux étagements alpins sur lesquels les activités et les sociabilités sont puissamment arrimées. Ainsi, la ville et les cousins d’en bas, le village et les parents en moyenne montagne, l’alpage et le chalet en haut, la crête et la cime tout en haut.
À la vallée à 500 m dévolue aux services, à l’industrie ou aux vergers succèdent les vignes puis les prés et les champs jusqu’à 1000 m. Jusqu’à 2000 m, les bois alternent avec les pâturages en fonction de la vitalité du monde agricole. En certains lieux, des sections déboisées sont les terrain de jeu verticaux des sports d’hiver.
10/15. À partir de 1800 m et au-delà, les alpages ne luttent presque plus contre les conifères. C’est l’espace de l’élevage, de la traite et des foins (l’été) ; c’est aussi celui des vacanciers et des temps ludiques (beaucoup l’hiver, de plus en plus l’été). Pour finir, voici le règne du minéral, à mesure que les hectomètres s’ajoutent.
Sauf pour le chamois, la guide de haute-montagne ou l’alpiniste chevronné, la verticalité minérale est une succession fugace de micro-coordonnées diagonales : on y passe dans l’effort d’une journée, mais on n’y vit pas dans la durée sereine d’une année.
Le monde de la montagne, c’est beaucoup plus que la coordonnée verticale des sports extrêmes.
11/15. Pour certains skieurs alpinistes, on monte comme on descend : vite, très vite, la montre au poignet. La texture alpine est transformée en surface de temps chronométré et exporté en données GPS sur des logiciels de randonnées sportives.
Auront-ils fait l’expérience de la vie en diagonale ? Pour avoir grimpé et dévalé (voire avalé) des dizaines de cols alpins, je pourrais quand même répondre “oui”. La seule condition est de vivre ses expériences de manière variée, de savoir contempler et, parfois, de renoncer.
Inversement, l’éleveur de vaches laitières étagera ses activités de bas en haut, non pas à la journée, mais dans une année découpée en saisons. Il vivra une autre texture, une autre Alpe : une vie en diagonale plus mesurée mais plus dure. Il lui faut épouser la montagne à l’année et en affronter les contraintes multiples.
12/15. Dans les Alpes, le mode de vie agricole consiste à bien savoir étager ses activités. Mois après mois, on joue avec les altitudes et leurs aménités saisonnières.
Ainsi, on sera puissamment arrimé à des coordonnées horizontales réduites, entre l’écurie, le lieu de traite, la fromagerie et le pré où les vaches pourront (potentiellement) se libérer (un peu) les jambes en attendant l’inalpe, l’emmontagnée, bref la libération estivale de l’alpage.
Au même moment, 1000 mètres plus haut, certaines de nos stations-paquebots maximisent une autre horizontalité en offrant, sur un replat aménagé (souvent un ancien alpage), un circuit entre logements, services multiples, activités ludiques, parkings et gares. Toute une noria automatisée rend difficile la possibilité d’une fuite en diagonale.
13/15. Et vous, quelle est la courbe de niveau où vous savez que “c’est par là que ça se passe” ? Autrement dit, que “c’est ici et pas ailleurs” ? Vous savez ce lieu qu’on quitte avec arrachement quand le temps est venu de reprendre le chemin de la pente.
Dans mon cas, je situe mon étage préférentiel entre 2000 et 2200 mètres, au-dessus de la ligne sommitale des conifères et mais en-dessous du chaos minéral. Mes coordonnées chéries sont celles du monde de l’alpage. C’est de là que j’aime prendre la tangente.
14/15. Pour autant, depuis notre beau replat, la polarité de la civilisation urbaine nous incite toujours à nous arrimer au fil-à-plomb afin de rejoindre la civilisation du contre-bas. Est-ce parce qu’une vie de montagne nichée dans une seule courbe de niveau est un rêve d’ermite auto-suffisant (ou d’aménageur du Plan Neige) ?
Majoritairement, les Alpins et les Alpines sont formidablement mobiles entre leurs coordonnées montagnardes.
15/15. Par exemple, le professeur qui enseigne à 700 mètres pourrait bien prendre, lors de ses fins de journée de juin, son vélo et monter jusqu’à 1500 ou 2000 mètres. L’espace d’une montée d’1h30, il reviendra chez lui, à quelques kilomètres de son lieu de travail.
Chez lui, prendre la tangente, retrouver l’horizon et abolir la pente contraste avec son désir de s’enraciner et de faire son nid. Mais alors que faire de cette contradiction ? Doit-il mettre sous tension l’ici et l’ailleurs ? Doit-il partir pour apprécier de revenir ?

Dans un monde montagnard qui fonctionne en diagonal, rares sont les lignes droites de la plaine et de la métropole. C’est heureux car, hors des tracés rectilignes, on peut toujours se ménager une fuite, une liberté, un quant-à-soi.
Les coordonnées diagonales représentent parfaitement l’histoire millénaire de la montagne : un mélange entre une verticalité jamais absolue et une horizontalité mâtinée de changements d'altitude.
Ces coordonnées existentielles sont l’autre nom de la vie en montagne. Une vie composée de mouvements entre hauts et bas, de long en large, avec la joie des virages comme autant de replats avant de reprendre le chemin de l’ascension.
Bon chemin à vous,
Séverin Duc
⟶ Docteur en histoire, je suis l'auteur de plusieurs livres dont la trilogie en cours Les Alpes du Futur (disponibles aux Éditions Inverse).
⟶ Ma conviction forte de conférencier et de conseiller est que l'expérience historique est un formidable outil au service du futur des territoires alpins.
⟶ Mes offres sont sur mon site, et mon CV sur Linkedin.
⟶ Pour en discuter, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse suivante : severin.duc@backfuture.fr